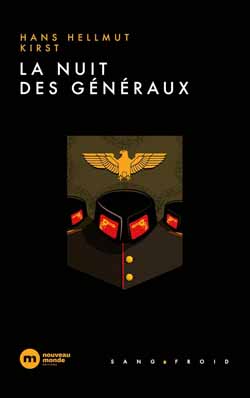
Au hasard de mes promenades dans une librairie, je suis tombé sur un roman de Hans Hellmut Kirst publié en Allemagne en 1962, « La nuit des généraux« . Ce roman est devenu un célèbre film éponyme d’Anatole Litvak, sorti en 1967 avec Peter O’Toole (Général Tanz), Philippe Noiret (Inspecteur Morand) et Omar Sharif (Major Grau).
En souvenir du film que j’avais apprécié il y a fort longtemps, j’ai donc acquis ce roman, dans sa version des Editions Nouveau Monde, collection Sang Froid et traduit par Pierre Kamnitzer. Cette édition n’est sans doute pas la meilleure car des fautes diverses s’y sont glissées à plusieurs reprises.
Film et roman suivent une histoire globalement similaire avec quelques différences et simplifications. A trois reprises, en 1942 à Varsovie, en 1944 à Paris et en 1956 à Dresde (ce dernier meurtre uniquement dans le roman), une prostituée est sauvagement assassinée. Malgré le contexte, un policier militaire allemand va enquêter, rejoint par un policier français. Le coupable est donc un général allemand. Le lecteur connait son identité puisqu’il assiste au deuxième meurtre mais encore faut-il que la police puisse réunir les preuves nécessaires. Cela s’avère particulièrement compliqué le 20 juillet 1944, alors que les Alliés avancent vers Paris et qu’un attentat contre Hitler vient d’échouer, attentat faisant partie d’une vaste tentative de coup d’Etat (l’opération Walkyrie) dans laquelle trempent plusieurs généraux allemand en poste à Paris.
L’histoire est bien construite et vise, au-delà de l’enquête policière, à nous glisser dans la peau de ces officiers allemands tiraillés entre des exigences souvent contradictoires. Les portraits acides des généraux, tantôt d’une cruauté totale, tantôt des pleutres bureaucrates, sont crédibles. La « nuit » du titre renvoie, sans doute, à la fois à la longue nuit du 20 juillet 1944 mais aussi à celle qui emplit l’âme des militaires et celle dans laquelle l’armée allemande a sombré.
Mais la forme, bien qu’originale, est parfois lourde. Le roman est en effet construit comme une succession de documents venant illustrer le récit d’un narrateur qui s’est basé sur des témoignages. Si cette manière de procéder est intéressante, elle ne facilite pas, en l’occurrence, la lecture.