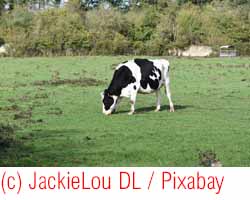
Ceux qui connaissent ce blog et son auteur savent à quel point j’exècre le végétarisme et le véganisme. J’ai déjà réalisé un billet « L’envahissante propagande végane« , généraliste, et un autre spécifiquement sur le cannibalisme, argument régulièrement ressorti dans la propagande végétarienne.
Il y a un aspect particulier que je n’ai malgré tout pas encore traité : le jugement moral sur le fait de manger de la viande. L’argument de base des végétariens est « il est mal de tuer un animal mais aucun problème pour tuer un végétal ». Voyons ici pourquoi cette différence, cette hiérarchie du vivant.
La justification moderne est le fameux concept fumeux de « sentience ». Mais revenons plutôt aux fondamentaux religieux.
Rappelons tout d’abord que la définition même de la vie implique que l’être vivant réagisse en cas d’agression. Une plante cherche à se défendre. Une plante communique avec ses congénères voire avec son écosystème. Un cas bien documenté est celui des plantes qui « appellent » des prédateurs pour des insectes en train de les manger en émettant une phéromone particulière. Bien sûr, le terme « appeler » est un peu anthropomorphe. Mais c’est pourtant un mécanisme réel. Donc, la « sentience » est et demeure une fumisterie anthropomorphe.
Ceci posé, si une plante est vivante, pourquoi la tuer ne serait pas « mal » ? Et pourquoi tuer un animal serait « mal » ?
Et c’est là que l’on se rend compte que le végétarisme a pénétré en Occident à chaque fois qu’une certaine élite intellectuelle ou bourgeoise s’est prise de fascination pour l’Inde, sa culture et ses religions. Cela a été le cas dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle comme dans les années 1960-1970. Aujourd’hui, le développement d’une certaine « spiritualité écologique » ou plutôt d’un « sentimentalisme » repose sur les mêmes principes, très très très loin de l’écologie scientifique (voire parfois en opposition). Brigitte Bardot est à l’écologie ce qu’un homéopathe est à la médecine : de la fumisterie anti-scientifique.
Dans les religions traditionnelles indo-européennes, notamment indiennes (les seules qui restent aujourd’hui) mais pas seulement, un animal est vivant. Il a une « anima ». Il est « animé ». Oui, le radical est le même : ce n’est pas un hasard. Une plante ne bouge pas. Elle n’est pas « animée ». Elle n’a pas d’ »anima ». Une plante ne vit pas. On ne peut donc pas la tuer. Donc la couper, la manger, ne pose aucun problème moral.
Dans les mythologies, on trouve des êtres humains condamnés à mort pour divers crimes par les dieux. Ils peuvent être transformés en statues de sel ou de pierre ou encore… en plantes. Être transformé en plante, c’est être tué. Parce qu’une plante n’est pas vivante dans ces conceptions du monde.
Dans les religions indiennes, le principe fondateur est celui de la métempsychose. Chaque être vivant (animal) possède une âme. Selon ses actes, son karma va l’amener à progresser dans une forme supérieure ou à régresser dans une forme inférieure. Cela implique une hiérarchie du vivant qui est l’exact inverse de la vision écologique qui repose sur l’équilibre des différentes formes de vie, toutes ayant la même importance. Manger un animal, porteur d’une âme, est donc comme le cannibalisme car l’âme qui l’habite est une âme potentiellement humaine dans une incarnation future ou passée. Il est impossible d’être réincarné en plante car une plante n’a pas d’ »anima ».
Toutes ces conceptions archaïques sont évidemment ridiculisées par la science moderne. Une plante est bien vivante. Une algue est vivante. Un microbe est vivant. Tout autant qu’un animal. Tous ont autant de « sentience ».
L’enseignement premier de l’écologie scientifique est que l’homme est un animal comme un autre. Il appartient à un écosystème : il mange et peut être mangé (il l’est d’ailleurs quand il meurt, au minimum par des bactéries). Il n’y a aucune morale à considérer dans le fait de se nourrir de tels ou tels types d’êtres vivants. L’obligation faite aux humains est la même que celle faite à tout être vivant : respecter son écosystème et l’équilibre général de celui-ci, sous peine d’en être privé et donc de disparaître.
On remarquera que, en dehors de la sphère indo-européenne, de telles conceptions sur l’ »anima » n’existent pas. Et le végétarisme ne s’y développe que sous influence occidentale. Dans le shintoïsme, chaque plante est vivante et possède une âme. Dès lors, il n’y a pas de différence entre tuer une plante ou tuer un animal. Le faire inutilement est un péché dans les deux cas. Il en est de même dans toutes les cultures animistes un peu partout sur la planète.